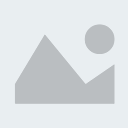Janvier 1931
• VIệT-NAM /
La Révolution prolétarienne (numéro du 5 octobre 1930 [p. 13]) publie des notes de M. Jacques Sternel relatives à la façon de juger de la Commission criminelle du Tonkin. Au mois d'août 1930, à Hanoï, comparaissaient devant elle 154 Annamites, poursuivis, les uns pour affiliation au parti révolutionnaire nationaliste annamite, les autres, pour affiliation au parti communiste annamite :
J'ai suivi plusieurs séances de ce procès et voici comment les interrogatoires s'y passent.
Le président à l'interprète, car le président, bien qu'il soit un administrateur des services civils, ne parle pas la langue annamite :
« Appelez-moi Nguyen-Van-Nem ».
Détaché par un gendarme de l'un de ses co-détenus avec qui il fait menotte, poignet contre poignet, Nguyen-Van-Nem, pieds nus, tète nue, le crâne tondu, ras, vêtu du large costume blanc des prisonniers, matricule en noir sur le devant de la poitrine, vient se présenter à la barre. Le plus souvent, c'est un paysan de vingt à trente ans, dont le visage asiatique ne laisse rien percer des sentiments qui l'animent.
L'interprète : « C'est bien vous, Nguyen-Van-Nem ».
L'accusé répond oui, ou fait un signe approbatif de la tête.
Le Président : « Vous avez été dénoncé par un tel, un tel, un tel comme ayant assisté à telle réunion secrète du Viet Nam, le reconnaissez-vous ? »
L'accusé, neuf fois sur dix, nie le fait.
Le Président : « Vous niez aujourd'hui, pourtant vous avez avoué à l'instruction ».
L'accusé : «J'ai avoué parce qu'on m'a torturé pour m'arracher ces aveux »,
Le Président : « C'est la première fois que vous parlez de ces tortures. Si vous avez été torturé, pourquoi n'avez-vous pas fait constater par un médecin les traces des tortures qui vous ont été faites ? C'est une excuse que maintenant vous donnez tous, Vous vous êtes tous entendus en prison pour faire cette même déclaration... Au suivant ».
L'interrogatoire a duré trois minutes.
Ah ! en voici un qui est un tirailleur.
Le Président : « Vous avez été dénoncé comme ayant pris part à la mutinerie de Yen-Bay. Le soir de l'attaque, on vous a vu portant des bombes et des coupe-coupe ».
Le tirailleur : « Non, ce soir-là, j'étais chez moi, auprès de ma femme. Les tirailleurs matricule n° tant, n° tant, n° tant (il en a indiqué trois) peuvent en témoigner ». Il invoque aussi le témoignage d'un sergent français. « Le lendemain matin de la révolte, j'ai fait partie des troupes qui ont repoussé les mutins ».
Pas un des avocats qui sont là pour défendre les accusés (ils sont trois ou quatre jeunes avocats assis au banc de la défense, continuellement en train de feuilleter des dossiers), ne s'est levé pour demander qu'on entende les témoins cités par le tirailleur.
Naturellement celui-ci a été condamné comme les autres.
Les 154 Annamites ont tous été condamnés : 12 à morts, 111 à la déportation perpétuelle, 11 aux travaux forcés à perpétuité et les autres aux travaux forcés, a la réclusion et à la prison à temps.
M. Sternel termine par ces lignes que nous voudrions pouvoir démentir :
La Fédération socialiste du Tonkin ne va plus pouvoir maintenant reprocher au gouvernement son excès de mansuétude.
• COMPRENDRE LES SPORTS /
Les grands journaux annoncent parfois des choses scandaleuses, mais ils ont soin de les enrober dans un commentaire plein de poudre et de miel. Le bon public avale le tout sans sourciller. Nous voulons mettre à nu le scandale. Ainsi, dans le Journal du 6 novembre dernier, M. Maurice Pefferkorn explique de quelle façon sont achetés et vendus les professionnels du sport. M. Maurice Pefferkorn trouve cela très bien : il y a tant d'hommes qui se font esclaves pour de l'argent ! Voici l'odieux maquignonnage :
L'achat d'un grand joueur de football, en Angleterre, se monte à plusieurs centaines de mille francs. Il atteignit môme 1.300.000 francs pour David Jack, le célèbre avant d'Arsenal, que nous verrons mardi à Colombes, et 1.100.000 francs pour Alex James, autre vedette d'Arsenal.
Les règlements de la fédération anglaise de football exigent qu'un joueur susceptible de changer de société soit inscrit par son club sur une liste publique de transferts. L'offre et la demande jouent alors ouvertement entre le club qui possède et ceux qui veulent acquérir.
Et c'est, en somme, assez normal, car la cellule, en football, ce n'est pas l'individu, mais l'équipe. C'est grâce h l'équipe, donc grâce au club, qu'un joueur se met en vedette. Toutefois, le joueur transféré, touche une indemnité sur le prix de son transfert, indemnité qui varie de 10 à 30 0/0 du prix qu'on l'a payé. David Jack, ayant été acheté 1.300.000 francs, empocha, ce jour-là, quelque 200.000 francs. L'on conçoit qu'à ce prix il y ait des gens qui se consentent à devenir esclaves.
Ainsi donc, si l'on vous paie assez, il n'est pas immoral que vous soyez l'esclave d'un manager, d'un homme politique, d'un banquier, d'un directeur de journal. L'esclavage n'est pas mauvais en soi. Il suffit qu'il soit bien rétribué pour honorer celui qui le pratique et celui qui le subit.
• DIPLOMATIE /
À quoi servent nos diplomates ? L'Œuvre nous le révèle :
Le Moniteur officiel du ministère du commerce et de l'industrie publie une note relative à l'importation des christs français en Palestine.
Le consul général de France à Jérusalem a fait des démarches pressantes auprès des autorités palestiniennes, et celles-ci viennent d'accepter que les importateurs français d'objets de piété inscrivent désormais sur les christs de petit modèle la mention « M. I. France » au lieu delà mention « Made in France »...
À Rome les augures ne pouvaient se regarder sans rire ; nos diplomates ont plus d'empire sur eux-mêmes et plus de métier : ce sont des humoristes à froid.
Février 1931
• L’HOMME MÊME /
Dans les Pages Libres de la Grande Revue (numéro de novembre 1930), M. Gonzague Truc constate que l'homme a perdu le sens de la méditation et se contente de notions qui donnent à sa culture un caractère purement utilitaire et pratique :
L'homme n'est plus sur le plan de l'âme où le maintenait l'ancienne culture. Il a perdu le souci de savoir quel il est, où il va, il cesse d'entendre même, n'y pensant point, le salubre avertissement de la mort. Envahi, entraîné, possédé par des appétits où il s'abandonne sans frein et qui, à mesure qu'ils croissent, rencontrent aussi à se satisfaire des difficultés croissantes, il ne songe qu'à s'armer pour s'assurer la puissance. Son affaire, c'est la conquête matérielle du monde, non la maîtrise de soi et toutes ses pédagogies s'orientent vers ce nouvel objet.
Il n'a plus en main la fine balance justicière des actes et des pensées, mais le dur levier qui lui permettra de soulever et de bouleverser la terre. À ses enfants, il impose d'acquérir non point une méthode pour comprendre et pour se comprendre, mais une technique pour fabriquer. Et c'est pourquoi l'éducation présente mène à la machine et détourne de l'esprit ou plutôt ne prend de l'esprit que ce qui est nécessaire pour la machine.
Si pourtant la civilisation, nous le croyons encore, est vie intérieure, conscience morale, beauté de l'acte, gentillesse de l'esprit et accroissement de soi, si elle se marque par la grandeur des êtres, non par l'infaillibilité des mécaniques, si elle est de l'âme, non du corps, qui pourra soutenir que c'est ici une civilisation ?
La barbarie, par contre, se marque de tous les traits qui permettent de nous définir. Elle est absence de pensée spéculative, souci exclusif de l'heure et des besoins de l'heure, soumission sans examen à des lois de pure contrainte, vie grégaire et inconsciente, rupture de tout commerce avec des dieux intelligents. À cela, on répondra que nous ne nous coiffons pas d'un chapeau de plumes. Mais on peut-être un sauvage et dîner en habit.
Or la civilisation figure l'exceptionnel, la réussite instable, et la barbarie, invisible quoique proche, a de prompts retours. Nous voyons où nous sommes quant au spirituel. Il ne faudrait pas trois guerres comme la dernière pour peupler de nouveau de roseaux solitaires l'île de la Cité, pour ramener sur les ruines du Panthéon des troupes de chevaux sauvages.
• COMPRENDRE LES SPORTS /
Les sports, tels qu'on les pratique aujourd'hui, sont une preuve de la barbarie de notre époque. Qui dressera la liste des victimes annuelles du rugby, des courses, de la boxe ? On ne pourra plus déplier une feuille d'informations sans trouver le récit d'un fait-divers analogue au suivant :
Lille, 29 décembre. — Au cours des championnats du Nord de boxe, réservés aux amateurs, et qui se sont déroulés aux Ambassadeurs, Fontaine, qui rencontrait Dujardin, a été mis knock-out par son adversaire.
Comme après les dix secondes réglementaires, le boxeur restait toujours étendu, on s'empressa autour de lui. Malgré tous les soins, on ne put le rappeler à lui. Il a été transporté à l'hôpital de la Charité, où il est resté dans le coma.
On suppose que Fontaine, après avoir reçu le coup qui le mit knock-out, s'est fracturé le crâne en tombant sur le ring. — (Journal)
On suppose... C'est le début d'une de ces phrases dont la grande presse se sert lorsqu'elle veut détourner l'attention du lecteur d'un l'ait scandaleux, à savoir ici : un championnat meurtrier.
• 4E POUVOIR /
Le Canard enchaîné (numéro du 24 décembre 1930) sous le titre « L'édition rentrée », révèle une aventure qui montre bien que le souci des journaux les plus répandus n'est pas tant d'informer consciencieusement le public que d'utiliser les faits pour assouvir les passions de leurs propriétaires, assurer le triomphe de leurs hommes, en bref, faire prospérer leurs petits commerces :
Si M. André Tardieu fut le premier surpris de la tape mémorable qu'il ramassa jeudi, notre national Intransigeant, lui aussi, tomba de haut.
On n'a même pas fait assez de succès à certaine édition spéciale, entièrement composée d'avance, où s'étalait, en première page, sur trois colonnes, ce titre triomphal :
CHUTE DU MINISTÈRE STEEG
Le Cabinet est renversé
Par... voix contre...
Suivaient des commentaires triomphants, où il était exposé en substance que M. Léon Bailby l'avait bien dit, que la chose était courue d'avance.
Quand arriva le coup de téléphone annonçant le résultat du pointage, ce fut à l’Intransigeant une manière de désastre.
— Démolissez les formes et décommandez les rotatives, ordonna M. Léon Bailby : il n'y aura pas d'édition spéciale.
Mais l'opération ne fut pas réalisée assez vite pour empêcher un certain nombre de morasses de passer à l'extérieur pour l'esbaudissement des camelots.
Des morasses qui mériteraient la place d'honneur à l'exposition du Syndicat de la presse parisienne, dont M. Léon Bailby, le lendemain même, fut élu président.
L'idéal de cette grande presse ? Obliger tout événement à devenir sa chose, son défenseur, son esclave.
• TRAITÉ DE VERSAILLES /
Pour pallier à la crise économique, on a demandé aux Français d'avoir de la bonne humeur ! Cela sera-t-il suffisant pour que cette scène d'Allemagne, décrite dans Monde (numéro du 25 décembre 1930) ne se renouvelle pas chez nous ?
Il y a près de quatre millions de chômeurs en Allemagne, à la date du 15 décembre ; on les voit errer en groupes, déambuler solitaires dans les rues de la ville, ou faire de longues queues a la porte des soupes populaires. Leurs visages sont tirés et leurs membres las. Les scènes de la vie des chômeurs ne manquent pas d'un « pittoresque » sinistre et souvent bizarre.
Deux « Schupos », une récente nuit, virent la vitrine d'un grand magasin brisée. Croyant à un cambriolage, ils pénétrèrent dans la vitrine, revolver et lampe électrique au poing et virent avec stupéfaction un homme... qui dormait sur une chaise longue. Conduit au commissariat, l'homme, un chômeur s'expliqua :
— Je n'ai pas étendu mon corps depuis dix nuits... J'ai vu la chaise longue qui paraissait si confortable... J'ai été vers elle...
• RÉFRACTAIRE /
Tous lecteurs de cette revue voudront entendre la Déclaration de paix qu'adresse Georges Pioch, dans le Réfractaire (numéro de novembre 1930) aux hommes de bonne volonté.
La Rue est furieuse et se remplit d'ivrognes.
Soit. Je n'y ferai pas un ivrogne de plus.
Que le soleil des morts se lève sur vos trognes,
Guerriers où la Bêtise admire ses élus !
À vous tous sans éclat, à vous toute sa gloire,
Tout son alcool aussi, qui ne se peut cuver.
Vivre en paix, c'est banal. Il vous faut de l'Histoire,
Dût l'Europe en mourir et la terre en crever !
« C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie »,
— J'en atteste ces preux : Franklin-Bouillon, Mandel —
Que de tuer de l'homme et de donner sa vie,
Allemand, pour Thyssen ; Français, pour de Wendel.
Mourir pour le Comptoir, la Banque, la Boutique ;
Briey, pour ta minette : et pour tes hauts-fourneaux,
Meuse, ô département super-patriotique
Par tes Poincarés secs et tes longs Maginots I
Mourir pour ce qui fraude, usurpe, affame, opprime,
Avilit la science, abrutit le travail,
Pour ce qui réduit l'homme au destin du bétail,
Déshonore l'effort, divinise le crime ;
Mourir pour égaler les jeunes aux anciens
Dans la stupidité d'être l'engrais du Riche !
Car c'est pour ça qu'on meurt ! et pour ça qu'on défriche...
Haut les pieds ! Bas les cœurs ! Aux armes, citoyens !
La France est en danger ! En danger, l'Italie !
Et l'Allemagne donc !... Mais qui n'est en danger ?...
Tel exige son or. Tel rêve à se venger.
« Allez, disait Barrès, enfants de la Patrie I »
Éteignez l'horizon (bah ! qui n'est pas mortel ?)
Et faites-nous, héros passifs, un cimetière
Si profond dans la boue et si grand sous le ciel
Que l'Europe s'y puisse étendre tout entière.
Creusez-le, toutefois, sans mon aide, ô troupeaux !
Qui vécut pour la Paix lui doit rester fidèle.
Si j'ai goût à mourir, je ne mourrai que d'elle.
Mon linceul ne sera pas cousu de drapeaux.
Je suis concitoyen de tous les pacifiques ;
Et leurs simples travaux me tiendront lieu d'exploits.
Je quitte à de plus fous le mal d'être héroïques,
Aimant trop à servir pour ruer sous leurs lois.
J'ai faim d'un autre honneur et fureur d'autres tâches...
Qui s'oblige à tuer, mérite ses bourreaux...
Il faut bien, à la fin, que la guerre ait ses lâches
Pour que l'Homme et la Paix survivent aux héros !
• MARÉCHAL DE FRANCE /
Les journaux ont reproduit le télégramme adressé par « la Casa de Catalunya » à Madame Joffre, à l'occasion de la mort du maréchal :
« Catalans Paris expriment douleur Madame Joffre irréparable perte illustre Catalan libérateur humanité. »
Aucun n'a publié, par contre, ce passage du livre de Gheusi (la Gloire de Gallieni, pages 18 & 19) :
Il faut relire ces ordres (du G. Q. G. se replier derrière la Seine (Instruction générale n° 4 et note secrète aux commandants d'armées) de « s'y fortifier et de s'y recompléter par les envois des dépôts. »
L'offensive tant « prévue » était donc considérée comme impossible par le G. Q. G. La preuve en est écrite dans la lettre du généralissime au ministère de la guerre et au maréchal French (2 septembre) : « En raison des événements qui se sont passés depuis deux jours, je ne crois pas possible d'envisager actuellement une manœuvre d'ensemble sur la Marne avec la totalité de nos forces. »
Mars 1931
• POÈTE PROLÉTARIEN /
Les Humbles (janvier 1931) publient une farce inédite du regretté Georges Chennevière, à qui M. Maurice Parijanine adresse un hommage ému et bien mérité :
Le 23 août 1927, nous avons accompagné à sa dernière demeure un camarade dont le souvenir nous reste précieux.
Il avait choisi le nom de Georges Chennevière parce qu'il aimait la fruste et puissante nature. Il a admiré et chéri tout ce qu'il a pu rencontrer dans la vie de forces bienfaisantes. Né du peuple, il est resté peuple avec amour, fermeté et simplicité. Pourtant il lui eût été bien facile de faire une carrière bourgeoise. C'était un des hommes les plus cultivés de son temps. Son érudition n'était jamais superficielle et elle était d'une étendue phénoménale. De plus, il possédait ce don rare entre tous d'être un vrai poète.
Après avoir subi la guerre, il s'est attaché à remplir plus fidèlement que jamais ce qu'il considérait comme sa mission ; il a voulu être un créateur de beauté et de bonté, de force et de foi. C'est dire qu'il devait être hardiment révolutionnaire. Il l'a été jusqu'au bout.
Nous ne saurions trop rappeler de quelle valeur fut sa collaboration à l’Humanité. Rien de ce qu'il y écrivit ne devrait être oublié.
II y mettait la forme, il y apportait le fond. Il n'a pas signé une seule phrase négligeable, sur les sujets les plus ardus. Familièrement et clairement, il expliquait des problèmes de science ou de littérature, il commentait des morceaux de musique et des pièces de théâtre. Il était l'intelligence complète et l'amour vivifiant. Avec cela, combatif et dur pour les ennemis du prolétariat. Il s'est tout entier donné à la cause communiste parce qu'il y croyait inébranlablement, et le dernier de ses poèmes, Pamir, son chef-d’œuvre, l'atteste sans équivoque.
Il faut lire, il faut répandre l'œuvre de ce beau poète, une des plus grandes figures de l'art prolétarien.
• FÉLIBRIGE /
Dans Marsyas (janvier 1931) de pertinentes remarques de M. Sully-André Peyre à propos du centenaire de Frédéric Mistral :
Le Centenaire a peut-être cristallisé quelques idées. Pas mal de platitudes et de sottises, aussi, émanant de critiques à la tâche, que les anniversaires même séculaires trouvent toujours mal préparés, parce qu'ils ne sont pour eux qu'un des aspects de l'actualité, courtisane fuyante et stupide.
Certains critiques parisiens sont encore irrités par Mistral, je crois. Certains Provençaux n'échappent pas encore à l'admiration béate, et parlent de lui avec une bouche pleine de guimauve.
C'est parce que Mistral est encore trop près de ceux-ci et trop loin de ceux-là.
• ACAD. Frse /
La Revue de France (1er janvier 1931) publie Ébauches de pensée de Paul Valéry. Voilà un titre excellent et fort bien approprié. Tellement bien approprié qu'il conviendrait peut-être de l'étendre à toute l'œuvre de M. Paul Valéry.
• PERFIDIE ÉPISCOPALE /
M. Félix Sartiaux étudie dans Europe (15 janvier 1931) la personnalité et l'œuvre de Joseph Turmel, excommunié en novembre 1930. L'abbé Turmel collabora à la Revue d'histoire et de littérature religieuses, à la Revue de l'histoire des religions, et publia dans la collection Christianisme [Rieder] et la collection les Textes du christianisme [Rieder] plusieurs volumes sous des noms d'emprunts : Louis Coulange, André Lagarde, Alexis Vanbeck, Armand Dulac, Henri Delafosse, Edmond Perrin, Hippolyte Gallerand, etc. Condamné une première fois le 23 janvier 1930 (interdiction d'exercer tout ministère), il continua à être attaqué par ses ennemis qui voulaient son excommunication :
C'est alors que Turmel fut sollicité par son archevêque, dans des conditions si perfides, que, pour ne pas accuser Mgr Charost à la légère, je reproduis les faits tels qu'ils ont été notés au jour le jour pendant la dernière semaine de mars (1930).
Le 25 mars 1930 Turmel avait adressé au cardinal, sur sa demande, une lettre où il se reconnaissait l'auteur des écrits signés Herzog, Dupin et Gallerand.
Le 26, le vicaire général vient voir Turmel et, d'un ton obséquieux et embarrassé, lui dit : « Je suis obligé de vous informer que vous êtes accusé d'être Coulange et que quelqu'un déclare être prêt à attester qu'il a vu le manuscrit de la Messe, dont l'écriture est identique à celle de vos lettres. Son Éminence demande que vous lui écriviez une nouvelle lettre pour déclarer que vous regrettez tous vos écrits, sans spécifier, et immédiatement votre chapelle vous sera rendue ». Effrayé par la perspective d'avoir à se débattre dans une nouvelle affaire et rassuré par la promesse formelle qu'un simple regret général lui rendrait tous ses pouvoirs, Turmel déclare séance tenante, oralement, être Coulange, Delafosse, etc. Le vicaire général le remercie avec effusion et réitère sa promesse.
Le lendemain 27 mars, Turmel envoie dans la matinée au cardinal la lettre demandée, qui, conformément à l'indication du vicaire général, se tenait dans les généralités. Le même jour celui-ci revient : « Son Éminence est enchantée de votre lettre, dit-il. Elle désire vous voir demain à 5 heures. Vos pouvoirs vous seront immédiatement rendus et vous reprendrez votre ministère, comme par le passé ».
Le 28, visite au cardinal. Accueil aimable. Celui-ci lui dit en riant : « Vous ne sauriez croire avec quel acharnement vos ennemis sont allés à la recherche de vos écrits... J'ai saisi Rome de votre affaire. Je ne puis donc vous rendre vos pouvoirs dès maintenant. Il faut attendre treize jours pour avoir la réponse qui, je n'en doute pas, sera favorable, étant donné la teneur de mon rapport ».
Le 1er avril, nouvelle visite, radieuse, du vicaire général : « Son Éminence m'envoie vous demander où vous préférez dire votre messe (il lui indique deux chapelles du voisinage, Turmel fait connaître sa préférence). La réponse de Rome ne va pas tarder ». Cette affaire étant réglée, le vicaire général ajoute presque à mi-voix : « En prévision des attaques que vos ennemis pourraient renouveler et qui pourraient amener Rome à prescrire une nouvelle enquête, Son Éminence vous demande de lui envoyer par écrit la liste des livres que vous avez publiés sous des pseudonymes. Mais il est entendu que tout restera secret. » Turmel envoie immédiatement la lettre demandée.
Le lendemain le cardinal Charost la fait parvenir à Rome. Elle est mentionnée par le décret d'excommunication : « Turmel, en deux lettres, l'une du 25 mars et l'autre du 1er avril 1930, adressées à Son Éminence le cardinal Charost, finit par avouer avoir écrit beaucoup d'articles et quatorze livres sous les quatorze faux noms qui suivent... »
Les mots en italiques établissent que le cardinal, ou son vicaire général, ont sciemment trompé Turmel. Il semble, en outre, bien difficile de contester que ces démarches successives n'aient été les étapes d'une comédie, préméditée pour arracher des aveux, en exploitant la naïveté du vieillard, sa confiance et son désir de recouvrer ses pouvoirs. Il est même probable que l'origine en remonte plus haut, qu'elle à été concertée à Rome entre Mgr Charost et le Vatican, et que le jugement bienveillant du 23 janvier n'était qu'un premier épisode destiné à intimider Turmel et à préparer les manœuvres, qui, en le mettant en confiance, devaient progressivement l'amener aux aveux.
Cette subtile et savante tactique mérite d'être retenue comme un bel exemple d'astuce ecclésiastique.
• POÉSIE /
M. Robert de Bédarieux comble ses bons amis ! Ils lui ont dit : vous êtes tout à la fois Baudelaire et Hugo. Et voici qu'il publie dans l'Essor (décembre 1930) des stances promises à l'immortalité :
Un vers est peu souvent par le sort, protégé,
Et, lecteur, c'est pourquoi je suis dans l'épouvante.
Sois généreux, ma Lyre est ici ta servante,
Et je veux que ces chants t'aient ce jour cortège...
... L'ennui te donnera sa lèvre négative.
La femme est un triangle et sa force est aux pointes.
L'homme sera parti pour gagner la pâture ;
La femme mentira sur l'emploi de son temps :
Et les jours formeront — quelle progéniture !
Un être adultérin qu'ils recevront contents !
Le lecteur se montrerait difficile s'il désirait être mieux cortège...
• COMPRENDRE LES SPORTS /
Encore un fait divers à classer sous la rubrique Le sport qui tue :
Au cours d'un match amical disputé entre l'équipe troisième (juniors) d'Hendaye, et celle de Biarritz, « la Négresse », un des joueurs de ce quinze, M. Georges Vainsot, âgé de 18 ans, fit en plaquant un de ses adversaires, une chute si malheureuse qu'il se rompit les vertèbres du cou. Après un court séjour dans une clinique de Bayonne, il fut transporté chez lui où, dès le lendemain, il succombait.
Encore un autre :
Le sous-secrétaire d'État de l'éducation physique vient de charger le médecin général Rouget d'aller enquêter immédiatement à Valence au sujet de l'accident mortel qui s'est produit dimanche dans cette ville, au cours d'un match de rugby.
Il est vrai que les journaux du 7 février publiaient l'information suivante :
Le médecin général Rouget qui, sur les instructions du sous-secrétaire d'État à l'éducation physique, s'était rendu à Valence pour enquêter sur la mort du jeune rugbyman Roumezy, survenue au cours d'une partie, est rentré à Paris.
De l'enquête à laquelle il a été procédé, il résulte que le malheureux accident s'est produit au cours d'une mêlée, et que le jeune Roumezy est tombé sous ses camarades, écrasé par ces derniers. Cette mort ne peut-être imputée, d'après le rapport, à une brutalité. Une information a été ouverte, qui semble, d'ailleurs, devoir aboutir à un non-lieu.
Aucun joueur n'ayant commis d'acte de violence, il faut conclure que le jeu est brutal par nature. C. Q. F. D.
En revanche, les coqs ne se battront plus :
Versailles, 18 janvier. — Des combats de coqs devaient avoir lieu cet après-midi à Cernay-la-Ville. Mais le maire de la localité, M. Aubry, ayant pris un arrêté interdisant cette manifestation, on prêtait aux organisateurs l'intention de passer outre.
Aussi, une centaine de membres de la Société protectrice des animaux, venus de Paris en autocars, sont arrivés vers 13 heures à Cernay-la-Ville, pour s'opposer à ces combats.
Les gendarmes, pas plus que les membres de la S. P. A., n'ont eu à intervenir, car les organisateurs avaient résolu, quelques heures plus tôt, de renoncer à leur projet.
Nous demandons la création d'une S. P. H. (Société protectrice des hommes).
• AUTODAFÉ /
Le Canard enchaîné du 7 janvier a publié cet écho savoureux :
Il y a quelques années, on trouvait à la Bibliothèque nationale de Rome un ouvrage intitulé Jean Huss le Véridique.
On ne le trouve plus aujourd'hui.
On ne le trouve pas davantage chez l'éditeur, ni chez aucun libraire de la péninsule.
L'auteur de ce livre avait écrit à la fin de sa préface : « En consignant ce petit livre à l'imprimerie, je formule l'augure qu'il suscite dans l'âme des lecteurs la haine pour toute forme de tyrannie spirituelle ou profane : qu'elle soit théocratique ou jacobine. »
L'auteur de Jean Huss le véridique s'appelait Mussolini. C'est pourquoi son œuvre s'est volatilisée.
• ITALIE FASCISTE /
Complétons cet écho par quelques extraits d'un article de M. Émile Laloy (Mercure de France, 1er février 1931) consacré au livre de Pietro Nenni : Six ans de guerre civile en Italie :
De Lausanne, Mussolini entreprit à pied le voyage pour Paris, coucha sous les ponts de la Seine, erra dans les quartiers de la Révolution, évoquant sans doute à chaque pas l'ombre de Marat qu'il aimait par dessus tout ; il fut appréhendé par la police et passa une nuit dans un poste pour vagabondage, puis il regagna la Suisse.
Il avait précédemment refusé de faire son service militaire, il retourna alors en Italie pour l'accomplir, puis alla à Trente pour y rédiger la feuille de Cesare Battisti le député irrédentiste ; ayant été expulsé d'Autriche, il était venu fonder la Lutte de classes. Il n'y connaissait qu'un appel : celui à la révolution. « Une bombe vaut mieux que cent discours », déclara-t-il après l'attentat de New-York. Nenni ayant été emprisonné pour avoir écrit après l'attentat d'Alba contre le roi : « Nous n'aurions pas versé une larme s'il était mort », Mussolini dans un discours de protestation, s'écria : « Que le citoyen Savoie tombe sous une balle de revolver, oui, cela nous est entièrement indifférent. Ce serait même justice ! » Ferrer ayant été fusillé, Mussolini, par représailles, fit démolir une colonne surmontée de la Vierge. Quand eut lieu la grève d'Ancône en juin 1914, il excita à la résistance : « Cent morts à Ancône et toute l'Italie est en feu », disait-il. La guerre survint. Mussolini, qui dirigeait alors l’Avanti, organe officiel des socialistes unifiés, fut pendant deux mois anti-interventionniste. « Mais de puissantes influences s'exercèrent sur lui ; Battisti, le député de Trente voué à l'échafaud, Marcel Cachin, le Belge Jules Destrés [sic], d'autres encore, essayèrent de le décider â changer d'attitude. De France, on lui promit de l'argent pour fonder un journal. » Après « une très courte hésitation », il fonda le Popolo d'Italia pour prêcher la guerre. On le cita alors devant les dirigeants du parti et on y réclama son expulsion. Comme dans le brouhaha d'une assemblée surexcitée, il n'arrivait qu'avec peine à se faire entendre, il brisa sur la table le verre et cria : « Vous me haïssez parce que vous m'aimez encore ! » Puis, ajouta : « Si vous croyez m'exclure de la vie publique, vous vous trompez. Vous me trouverez devant vous vivant et implacable ». Il sortit sous les huées. « Sans transition, il devint l'accusateur et le diffamateur de ses camarades de la veille ».
Avril 1931
• DURA LEX /
Dans le Mercure de France, du 15 janvier 1931, M. Émile Laloy rend compte du livre de MM. René Gérin et Raymond Poincaré : les Responsabilités de la guerre. Il n'approuve pas la thèse de M. Gérin, et c'est son droit absolu ; mais de quel droit invite-t-il le gouvernement à poursuivre un auteur dont les idées ne sont pas les siennes ?
Le gouvernement n'ayant pas sévi contre le fonctionnaire Gérin à raison de son livre, la haine de ce dernier contre le bon droit de la France est devenue de la rage et dans une conférence au Club du Faubourg, le 8 novembre 1930, il a osé dire : « La thèse que l'Allemagne a été seule coupable de la guerre mondiale est un mensonge et une infamie ; le gouvernement français souhaitait la guerre et la préparait depuis longtemps. »
M. Émile Laloy nous permettra de lui rappeler qu'il adopte exactement l'attitude des gens qui invitaient jadis le gouvernement à sévir contre le « fonctionnaire Gourmont » à raison de son article intitulé « le Joujou patriotisme ». Le gouvernement obtempéra aux injonctions des Laloy de l'époque et le « fonctionnaire Gourmont » fut destitué.
Sur quoi, il devint collaborateur du Mercure de France... Que les temps sont changés !
• PLACE AUX JEUNES ! /
La Revue des Visages s'est transformée. Une partie de chacun de ses numéros est consacrée à une personnalité contemporaine (en janvier-février, M. José Germain). La seconde partie comporte des pages sur les Lettres, les Arts, le Théâtre, des Contes, Nouvelles, Poèmes, etc. Cette transformation procure à M. Henry Liberge l'occasion d'écrire dans « le Règne de l'homme », (1er mars 1931) des lignes fort savoureuses :
La Revue des Visages, 4, rue Pommier, Villeneuve-Saint-Georges, nous informe qu'elle modifie sa formule et accueillera désormais les talents nouveaux. Cela nous vaut de lire dans son premier numéro, nouvelle série, des articles de jeunes qui nous paraissent réellement pleins d'avenir. Citons J. et J. Tharaud, José Germain, Rosny aîné, Paul Chack, Roland Dorgelès, Charles Le Goffic. Nous croyons ne pas devoir nous tromper en prédisant que, grâce à la Revue des Visages qui vient de les révéler au public, ces talents nouveaux s'affirmeront et connaîtront la célébrité.
On comprend pourquoi « le Règne de l'homme » porte, en sous-titre : organe de rénovation humaine et sociale.
• VOIX D’EN BAS /
Le numéro de mars de Nouvel Age, contient une étude de Madame Judith Cladel, sur son père, l'écrivain Léon Cladel, dans toute l'œuvre de qui apparaît l'amour du peuple, l'amour des déshérités et des prolétaires :
Aux humbles, aux pauvres, il fut fidèle : Les Va-nu-pieds, Gueux de marque, Quelques Sires, Raca, ne sont que la peinture de leur misère, la traduction ardente de leurs doléances et de leurs espoirs.
On le lui fit durement payer, plus encore après sa mort que durant sa vie. Car, présent, il était redoutable ; on n'osait guère s'attaquer à si rude escrimeur, mais lui disparu, des rancunes qui ne désarmaient pas organisèrent le silence autour de sa grande œuvre que l'on espérait bien voir s'enfoncer peu à peu sous les eaux de l'oubli.
• LE COUPABLE, C'EST LA VICTIME /
Rochefort, 6 mars. — Un Sénégalais du bataillon de tirailleurs de Saintes vient d'être victime d'un accident qui vaut d'être rapporté. Récemment incorporé, et placé en sentinelle, par une nuit très froide, il crut, malgré toutes les explications qui lui furent données, qu'il ne devait pas bouger. Pendant trois heures, il garda une telle immobilité que ses deux pieds gelèrent. Il ne révéla pourtant à personne qu'il souffrait cruellement des pieds, et il parvint à garder le silence durant dix-sept jours. Lorsqu'il parut devant le médecin, celui-ci le fit transporter à l’hôpital mari- time de Rochefort, où en raison de la gangrène, on dut procéder à l'amputation des deux pieds. (les Journaux)
Imaginez que la France soit une colonie russe, que les Français accomplissent leur service militaire à Leningrad ou à Moscou, qu'un paysan breton terrorisé par le cas du refus d'obéissance, et n'ayant pas compris la consigne donnée dans une langue étrangère, soit victime d'un semblable accident, que dirait notre grande presse ? Tout simplement ceci : ces Russes, quels sauvages ! Le Sénégal étant colonie française, il va de soi que le sauvage, c'est encore la victime.
• ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX /
le Progrès civique a publié contre les sports tels qu'on les pratique actuellement deux excellents articles. L'un est de M. Gabriel Reuillard (numéro du 14 février). Il faudrait le citer en entier. Faute de place, contentons-nous de reproduire ce passage si riche de vérités.
On ne fait plus du sport pour se développer, se cultiver physiquement, acquérir une forme et une performance parfaites. On fait du sport, d'une façon exagérée et parfois monstrueuse, pour devenir champion de ceci ou cela, sans souci d'équilibre et d'esthétique, souvent à rencontre du but soi-disant poursuivi. Et l'on devient souvent une espèce de monstre, développé à l'excès dans certaines parties, au détriment de la beauté et, ce qui est plus lamentable encore, de la santé.
À trente ans, c'est-à-dire en pleine jeunesse, en pleine force, un champion de boxe est fini. Il continue à traîner pendant quelque temps une existence aride, ingrate, et il meurt jeune, souvent tuberculeux, sans descendance.
L'autre est de M. Paul Lenormand (n° du 28 février). Il a plus particulièrement trait à la boxe :
Il n'en va pas de même dans les exhibitions du genre de celle dont nous venons de parler. Les boxeurs qui s'affrontent devant douze mille personnes ne le font pas pour l'amour de l'art. Ils se martèlent mutuellement le corps sans merci, ils cherchent le coup dur qui mettra hors de combat l'adversaire au risque de lui infliger — le cas n'est pas sans précédent — une blessure mortelle ; ils s'exposent eux- mêmes à sortir de la mêlée, temporairement ou à jamais estropiés, pour de l'argent. Ils s'apparentent ainsi aux gladiateurs de l'Antiquité qui s'entretuaient pour la plus grande joie d'une foule ivre de sang, avide d'émotions fortes, et la mentalité des spectateurs qui se disputent à prix d'or les meilleures places pour voir des hommes s'entr'assommer pour de l'argent ne nous semble pas très différente de celle de la tourbe romaine, dont on a si souvent flétri les bas instincts et la cruauté.
Ça n'est que trop vrai. Et il ne faut pas attendre des gouvernements qu'ils suppriment de telles exhibitions. Elles constituent la meilleure préparation des corps et des âmes à la guerre. S'il n'y avait les champions, les bandits et les casse-cou, où nos grands-chefs iraient-ils recruter ces purs héros : les nettoyeurs de tranchées ?
• MARIGOT /
« Dans l'Action Française [n° 80, 21 mars, 1931), M. Charles Maurras commente sévèrement la scandaleuse affaire de ce M. Couturier qui acheta sa rosette rouge. Ignorerait-il, le grand polémiste, que ce petit trafic est courant ? Il y a trois ans, un richissime banquier fut promu commandeur de la Légion d'honneur par le ministère de la guerre. Quels étaient les titres de Monsieur Lucien Sauphar ? On ne lui en connaît qu'un, indiscutable, celui-ci : « A su gagner plus de cent millions dans le même temps où un million et demi de Français étaient ensevelis au front. » C'était donc bien à un ministre de la guerre qu'il appartenait de décerner cette cravate si méritée ! M. Maurras, la Légion d'honneur n'attendait ni M. Falcoz ni M. Couturier, pour être déshonorée ! » (D'Artagnan)
Mai 1931
• POÉSIE /
La Grande Revue (numéro de mars 1931) publie deux poèmes de Pierre Frayssinet, mort le 16 décembre 1929 à l'âge de 25 ans. Poète musical et profond, Pierre Frayssinet s'exprimait déjà avec un accent très personnel. Voici quelques strophes de son Hymne à la solitude dédié à un ami lointain :
Le crois tu, Holderer, que les hommes des villes
Sachent rien inventer qui nous paraisse beau,
Eux qui n'ont jamais vu tes sables immobiles
Ou le mol horizon de mes simples coteaux ?
Crois-tu qu'il vienne un bien de leur hâte stérile ?
[…]
Si brusquement, dans un vallon paisible et calme,
Ivres de leur tumulte ils étaient emportés,
Seuls dans le flamboiement immense de l'été,
Ô toi qui sous le vent vois se plier la palme,
Sens-tu dans le soleil leur grise vanité ?
Et quand viendra le jour où la compagne rude
À chacun portera ce que voulut le sort,
Ou si quelque hasard ouvre une incertitude,
Ami ne crois-tu pas que ceux-là seront forts
Qui n'ont pas négligé l'austère solitude ?
• LE PEUPLE & LA GUERRE /
En Courné det houec est le journal des veillées du pays de Bigorre. Il paraît durant l'hiver, amuse, instruit intéresse toujours. MM. J[ean] Lahargue et René Escoula [1895-1965] en sont les animateurs. Ils méritent d'être loués pour leur bel effort de décentralisation et la valeur éducative de leur œuvre. M. J. Lahargue (numéro 1, hiver 1930-1931) s'adresse aux futurs citoyens et leur montre que l'intérêt du peuple n'est jamais dans la guerre :
La volonté du peuple, éclairée et librement consultée, ne serait jamais, jamais pour la guerre. Aussi bien se garde-t-on de consulter les peuples avant de les lancer dans la mêlée.
Le triomphe de la paix est lié au triomphe de la démocratie. Mais il faut que le peuple sache mériter et conserver le pouvoir. Aujourd'hui, il se contente d'être esclave en se croyant le maître...
[voir également : Jean Lahargue, les Étapes de la paix, Nîmes, la Laborieuse, 1930.]
• SOUFFLÉ /
M. Henry de Montherlant a trouvé asile dans la Revue européenne (numéro d'avril).
J'ai un petit copain qui est vautour au Jardin zoologique d'Alger. Exactement, il est vautour moine, de cette espèce que les Arabes prétendent capable d'attaquer la proie vivante. Sa couleur est pâle. Toutes les bêtes sont plus pâles dans le désert, comme si le soleil mangeait leur couleur. Et notamment les oiseaux : l'aigle, le faucon, le vautour, la crécerelle, le grand duc, la huppe. Le vivicide fait avec sa gorge un ridicule pépiement de moineau, et voile les yeux lorsqu'il m'aperçoit. Puis il se balance longuement d'une patte sur l'autre, comme pour provoquer l'extase religieuse, et faire honneur à son nom de moine. Quand il mange ses viandes, il étend dessus ses ailes, avec un geste maternel ; et c'est la même douceur que celle du lynx, quand il lèche un peu, d'abord, la charogne qu'il va dévorer. Car tout animal, depuis l'agneau jusqu'au lion, lèche sa proie avant de la dévorer. Un agneau, qui me prend pour un pis, me lèche, puis soudain me mordille si fort qu'il me fait mal. Mon petit copain maintient les viandes avec ses serres, tandis qu'il les déchiqueté par saccades, de son bec bleuâtre. Ce que voyant, M. Prudhomme s'exclame : « Il mange de la viande ! Saloperie, va ! »
Vincent me dit que les aigles, parfois, meurent de colère. C'est la mort de Jules II. Elle m'irait comme un gant.
M. de Montherlant finira-t-il par comprendre qu'en voulant nous épater à tout prix, il est simplement ridicule ?
• PUBLIC / PRIVÉ /
De l'article vigoureux et documenté consacré à Coty, « défenseur des honnêtes gens » paru dans Monde (numéro du 4 Avril) sous la signature de M. Arthur Lafon, détachons ce « moment » de l'histoire du grand homme :
Le 24 février 1926, le Figaro ouvre une souscription nationale pour recueillir des contributions volontaires et son directeur, afin de donner l'exemple, s'inscrit pour 100 millions payables en dix annuités égales. La seule condition posée est que la Caisse d'amortissement soit autonome, gérée par un comité de compétences extra-parlementaires et garantie par un article incorporé à la Constitution « contre toute entreprise, usurpation, intrusion politique ».
À la grande stupéfaction du parfumeur, Poincaré le prend au mot, constitue un comité national conforme aux indications du parfumeur et fait proclamer solennellement à Versailles l'autonomie de la Caisse.
Coty, qui avait l'arrière-pensée de créer une institution dont il aurait été le maître absolu et qui gouvernerait l'État, se fâche tout rouge : « La Caisse d'amortissement, écrit-il, soi-disant autonome est une institution d'État […]. Dans ces conditions, nous n'avons pas à fournir un centime... » et il ajoute qu'il prend l’engagement d'honneur de consacrer les cent millions promis à l'accomplissement d'une œuvre d'utilité nationale qu'il a longtemps méditée.
Les années ont passé. Coty n'a pas versé un sou à la caisse, médite toujours son œuvre nationale et, dans la seule année 1926, a doublé le chiffre de ses ventes grâce à l'énorme et gratuite publicité faite autour du geste du si généreux donateur. L'année suivante, le capital de la Société Coty est porté à 40 millions, il s'élèvera à 60 millions le 2 août 1928. Il a sept usines aux portes de Paris, 25 000 dépositaires en France et a remplacé sa Société suisse par la Coty Societate anonima romana, à Bucarest.
Juin 1931
• POÉSIE /
Notre éditorial d'avril a eu, pour heureux effet, d'engager quelques chroniqueurs à consacrer un article à Louis Pergaud. La Volonté du 8 Avril publie un Message de M. Fernand Demeure, visiblement inspiré par la lecture de notre dernier numéro. Pourquoi M. Fernand Demeure use-t-il d'un cliché, à propos de la publication partielle du Carnet de guerre de Pergaud :
Pourtant la guerre ne l'absorbait pas tout entier. Il [Pergaud] trouva le moyen pour échapper à son emprise brutale de composer un Carnet de guerre que des mains pieuses ont publié par la suite en partie.
Pourquoi ne pas nommer la seule revue qui ait fait cette publication : les Primaires ?
• CRUAUTÉ ORDINAIRE /
Dans Nouvel âge (mai), M. Charles Léger donne une étude, riche en détails peu connus, sur la vie et sur l'œuvre de Louis Pergaud. À beaucoup, elle apprendra la douloureuse adolescence de l'écrivain :
Fils d'un maître d'école franc-comtois, Louis Pergaud, qui naît à Belmont, département du Doubs, le 22 janvier 1882, sera aussi instituteur.
Le directeur de l'École normale de Besançon, en 1898, ne savait point dissimuler ses antipathies. C'était un pédagogue d'ancien régime qui faisait de la sévérité un fait, de la dureté une loi. Ses principes se ressentaient de son caractère. Il détestait le père de Louis Pergaud à cause de ses opinions politiques. Clérical, il ne pouvait admettre, ni tolérer des théories opposées. L'inspection académique avait également cette manière de voir, aussi sévit-elle sans ménagement, en 1899, contre Elie Pergaud le père, ce « rouge », en le reléguant dans un pauvre village, sur le plateau de Fallerans. C'était une disgrâce que le fils de l'instituteur n'oublia jamais, la considérant comme une iniquité.
Voici qui est plus grave. En février 1900, Louis Pergaud, élève-maître, apprend que son père est sérieusement malade. Une lettre reçue de Fallerans le presse de venir le prochain dimanche. Le directeur de l'École refuse. Il refuse l'octroi d'une permission, dans un tel cas, sous le prétexte que la demande ne lui est « pas adressée directement ». À quelques jours de là, un télégramme — envoyé au directeur cette fois — annonçait la mort de l'instituteur de Fallerans.
Louis part avec un congé. Il trouve, auprès du corps de son père, sa mère presque moribonde et son jeune frère. Il est inutile de dépeindre la douleur de cette maison où toute la richesse consistait en l'affection réciproque de ses membres. Les fonctions d'instituteur primaire chichement rétribuées alors par l'État ne facilitaient point l'épargne. La situation était précaire car le maître d'école de Fallerans mourait sans avoir droit à la retraite. La veuve, les orphelins, ne purent rien obtenir de l'administration, et, il leur fallait évacuer la maison commune pour laisser la place au successeur.
Un mois après, exactement, la mère de Louis Pergaud, épuisée, meurt de chagrin et de misère. Ce fut comme un effondrement pour ses enfants meurtris par la cruauté du sort.
La douleur de Pergaud, on en retrouve la trace dans ces lignes que publie aussi Nouvel âge et qui sont extraites d'un agenda tenu par Pergaud en 1900 à l'école normale de Besançon :
12 lundi. — Je n'ose plus empoigner mon carnet. Mon Dieu, je suis trop malheureux. Je suis désespéré.
21 mercredi. — Aujourd'hui, on vient me chercher à l'École, je ne sais pourquoi. Tristes pressentiments.
Maman est morte ! Oh ! c'est trop, mon Dieu ! Je veux la rejoindre. Je veux mourir. Oh, ma maman chérie ! Oh, est-ce possible ?
Mon pauvre Lucien ! Qu'allons-nous devenir ? Je deviens fou. Oh ! si tu n'étais pas là, bien sûr, je n'aurais pas le courage de vivre. Je me tuerais !
• VIE INTÉRIEURE /
L'abbé Bethléem qui a mis notre revue à l'index, sévira-t-il contre le vénérable Mercure de France ? Dans le numéro du 1er avril de ce périodique on a pu lire une lettre qu'il siérait de présenter ainsi : Le colonel Ramollot dit son mot sur le nudisme. La voici :
Paris, 2 mars 1931
Monsieur le Directeur,
Voulez-vous permettre à un fidèle lecteur du Mercure de vous adresser une simple réflexion à propos des études sur le nudisme que vous avez publiées ?
J'ai appartenu très longtemps à l'armée d'Afrique : zouaves, tirailleurs, dont les uniformes, et particulièrement les larges culottes, étaient, et sont encore, légendaires.
À cette époque, la médisance prêtait aux femmes d'Algérie le propos suivant : « C'est agaçant ! avec ces pantalons, impossible de savoir ce qu'ils pensent ! »
Or, ne croyez-vous pas que, quelle que soit la chasteté des nudistes, ils doivent bien tout de même... penser de temps en temps ? Alors, il arrivera fatalement que le hasard des rencontres réunira quelques jolies femmes et quelques jeunes hommes. Et si ces derniers se mettent à... penser tous en même temps, ce sera un bien curieux spectacle !
Veuillez agréer, etc.
Colonel d’Artiguemy
Il nous semble entendre le colonel :
— Scrongnieugnieu qu' m'a foutu ces clampins là qui' s 'f à poil ? Et les galons, alors, qu'vous en faites ? Les tatouer sur la peau ? T'nez Lorgnegrut, vais vous dire c'que j'en pense. Tendez bien c'que j'vous parle, et v'saisirez l'apoloche 1. Dans c'temps-là j'étais en Afrique...
• STRATÈGES /
Le tome II de la 3e série des documents français relatifs aux origines de la guerre vient de paraître à Paris chez l'éditeur Costes. La grande presse n'en parle pas et n'en parlera sans doute jamais : ils contiennent une certaine lettre datée du 28 mars 1912 écrite à notre ambassadeur à Londres par notre ministre des affaires étrangères, l'intègre Raymond Poincaré. Des copies de cette lettre devraient être affichées en caractères énormes dans toutes les communes de France :
... Il importe essentiellement que l'Angleterre ne s'engage pas à rester neutre entre la France et l'Allemagne, même dans l'hypothèse où l'attaque semblerait venir de notre fait. Pour ne prendre qu'un exemple, pourrait-on nous imputer légitimement la responsabilité d'une agression, si une concentration de forces allemandes dans la région d'Aix-la-Chapelle nous contraignait à couvrir notre frontière septentrionale en pénétrant sur le territoire belge ?
Le 4 avril, notre chargé d'affaires à Londres, transmet à Poincaré l'avis du gouvernement anglais :
... Il est très difficile de définir les mots : « attaque sans provocation », et l'Allemagne peut, par son attitude, amener la France à prendre certaines mesures qui auront les apparences d'une agression tout en étant réellement des mesures défensives. Telle serait, par exemple, l'entrée des troupes françaises sur le territoire belge, que les états-majors anglais et français considèrent comme nécessaire en certains cas.
M. René Gérin qui, dans Monde (numéro du 25 avril) commente cette correspondance écrit : « De tels documents ne sont pas graves par eux-mêmes ». Vraiment ? N'apportent-ils pas la preuve que la France et l'Angleterre se souciaient fort peu du respect de la neutralité belge, du droit des peuples, de la sainte cause de la justice ?
Le 4 août 1914, Raymond Poincaré déclarait dans son message aux Chambres :
L'Allemagne a outrageusement insulté la noble nation belge, notre voisine et amie...
Il était difficile de se moquer davantage de l'opinion française... Il est vrai qu'il s'agissait d'enflammer les cœurs et de mettre à côté de nos soldats, le Droit, la Liberté, la Civilisation, la Gloire, l'Équité, l'Idéal, etc. Allons, le président Poincaré a bien mérité de la patrie !
• POÉSIE /
La Proue (février 1931) publie un émouvant poème de Marcel Millet. Le poète qui a quitté Paris pour retrouver sa Provence natale, entend la nuit, dans sa retraite, le tir de nos vaisseaux :
Mes îles, polluées, leur serviront de cible ;
l'Escadre est dans nos eaux, et de nombreux complices
préparent la prochaine hécatombe mondiale.
L'évasion qui enivra sa jeunesse, le tente à nouveau, mais, hélas :
Tu voulais fuir... Partir ? Ils partent pour partir,
les poètes, mais tu n'as plus la jeunesse robuste,
tout est perdu, le cœur est lourd, les sanglots crèvent,
un remords déchirant vient mourir sur la grève.
Il faut subir, homme sans foi, il faut subir.
Ta disais ? Quoi ?... Tu veux ?...
Je dis : il faut subir.
Tu me réponds : ils ont rectifié leur tir...
Le vœu, ce dernier vœu... D'autres hommes plus tard...
Et ton enfant sourit dans le soir qui s'allonge,
un soir de paix lumineuse et fleurie,
avec un rêve ardent qui se prolonge...
1. Argot, déformation d'apologue, court récit argumentatif dont on tire une instruction morale : « Il répétait ainsi à tout bout de champ : comprends-tu l’apologue ? et comme il prononçait l’apoloche, de là lui venait ce sobriquet de Poloche… » (Émile Moselly, Terres lorraines, Paris, Plon-Nourrit & Cie, 1907, p. 32 – prix Goncourt). Le glossaire de la Pléiade fait valoir que le terme est repris chez Céline, le plus souvent sous la forme poloche, mais aussi, selon le critique Henri Godard « avec un sens qui n’est pas toujours exactement le même » (Céline, Romans, 3, nrf, 1988, p. 1149, n. 2). Voir encore : « C'que t'as l'air d'en dévider des apoloches champignols ! », Nonce Casanova, le Journal à Nénesse [de la Courtille, alias Ernest Touchon, assassin de la fille Adeline Miécher, condamné à mort], Paris, Ollendorff, 1911.
© 2019 - SARM